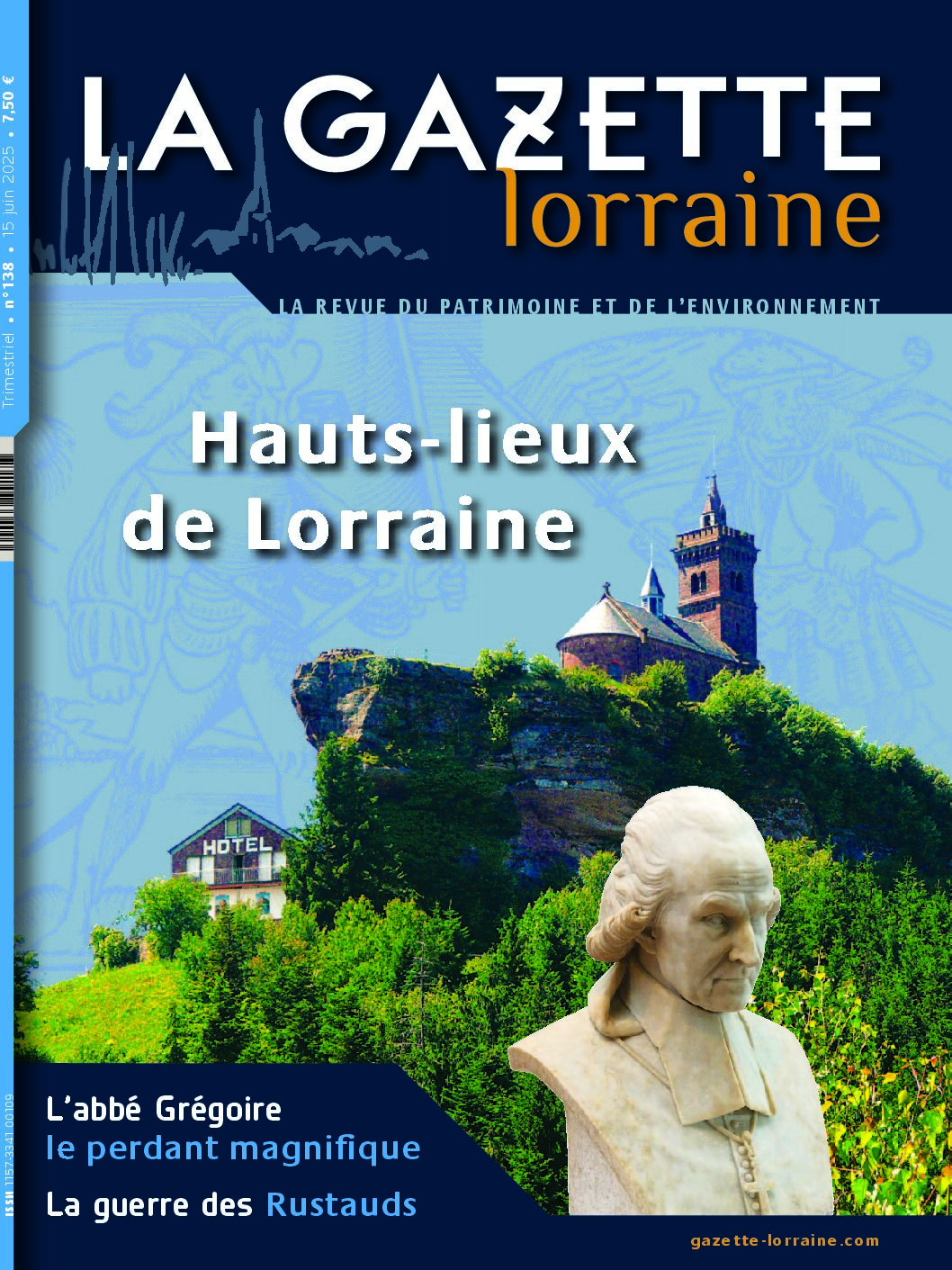Description
La Guerre des Rustauds, un miroir lorrain des luttes sociales
Par-delà les siècles, la révolte des paysans de 1525 interroge encore nos combats pour la justice et l’égalité.
En 1525, la Lorraine devient l’épicentre d’un séisme social : la Guerre des Rustauds. Écrasée dans le sang par le duc Antoine à Saverne, cette révolte incarne l’aspiration millénaire des opprimés à briser leurs chaînes.
Cinq cents ans plus tard, son héritage résonne étrangement avec les tensions contemporaines – précarité, défiance envers les élites, quête de dignité.
La Lorraine, l’Alsace et l’Empire Allemand, alors mosaïques féodales, voient éclater des revendications inscrites dans les douze Articles : abolition des taxes abusives, accès aux forêts communales, limitation des corvées…
À Saverne, la répression fait 18 000 morts en deux jours, selon les chroniques. Un bilan qui rappelle le prix du sang payé par les mouvements populaires face aux pouvoirs établis.
Dans sa « Guerre des paysans en Allemagne », publié en1850, Engels évoque dans ce soulèvement une « préfiguration des révolutions prolétariennes ». Son analyse matérialiste souligne comment la crise agraire et le ferment religieux ont alimenté la rébellion – un cocktail explosif que l’on retrouve aujourd’hui dans les soulèvements contre les inégalités sociales, climatiques ou financières.
Les Rustauds réclamaient « que nul ne soit tenu de donner au seigneur plus que ce qui est juste ». Une exigence que nul ne saurait contester.
De la plaine de la Sarre aux ronds-points lorrains, une même soif de justice sociale relie les siècles. Si Engels y voyait une « école révolutionnaire », cette guerre nous enseigne surtout la vigilance face aux fractures qui traversent nos territoires. Comme en 1525, l’histoire se répète – tantôt comme tragédie, tantôt comme espoir entêté de changer le monde.
Stéphane Wieser